Robert Linhart,
L'établi, 1978, Paris, Les Editions de Minuit, 176 p.
L'établi, film de Mathias Gokalp, avril 2023. Durée : 1 heure 57 mn.
L'histoire est celle, vraie, d'un étudiant qui "s'établit" ; dans le jargon des étudiants de l'année 1968, "s'établir" signifiait prendre un emploi d'ouvrier en usine, pour y préparer les luttes sociales et pouvoir envisager la Révolution. Le film reprend l'essentiel d'une année de la vie de Robert Linhart, étudiant en philosophie qui a travaillé presque un an dans les usines Citröen, à Paris, d'août 1968 à juillet 1969. Travail à la chaîne, travail fatigant, déclassant. Les ouvriers - et ouvrières - la plupart immigré-e-s, y effectuent un travail épuisant. Travail de montage des 2 CV ("deux chevaux"), travail "d'homme-chaîne".
Avec des acteurs habiles, comme Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès, et d'autres visages plus courants représentant des travailleurs immigrés, sympathiques, le film donne parfois des images proches des gens que l'on croise dans le métro, que l'on côtoie dans le bus, le matin de bonne heure ou en fin d'après-midi. Parmi ces travailleurs d'une usine de la vie parisienne, Porte de Choisy, Robert rencontre divers personnes qui font le "nous" : "parlant toutes langues, et venant de tous les pays, brassés, éparpillés, séparés, retrouvés, toujours autres et toujours proches" (p. 140). Reste, au bout d'une journée de travail, que cela construit la notion (ou le concept) marxiste classique de plus-value. "Quand j'avais compté mes cent cinquante 2 CV et que ma journée d'homme-chaîne terminée, je rentrais m'affaler chez moi comme une masse, je n'avais plus la force de penser grand chose, mais au moins je donnais un contenu précis au concept de plus-value" (p. 140).
Le livre et le film donnent à percevoir l'ambiance, tant sur le lieu de travail qu'au bistrot, le Café des Sports qui est devenu le coeur stratégique de leur bataille : le héros participe au déclenchement d'une grève, qui bientôt s'essoufflera. L'étudiant en philosophie, normalien, donc étudiant plutôt privilégié et raisonnablement payé, a pourtant lu Marx et Engels, ces prophètes qui racontaient et analysaient la lutte des classes de leur époque. Engels surtout, fils et héritier de grand patron, qui vivait la vie de cadre dans une usine anglaise et subventionnait régulièrement Marx. Mais de la lecture des livres à la vie en usine, il y a loin. A l'usine, on se bat ou pas, et aussi on peut se fait mettre à la porte. Ce qui arrive finalement à Robert.
Pourtant Robert Linhart en avait lu du Marx, des "Thèses sur Feuerbach" au Capital et aux livres de "théories sur la plus-value". Pourtant il avait entendu en rigoler (Althusser, "Althus / ser-à -rien", se moquait-on à l'époque !). Mais lui, il y croyait. Ce livre et le film qu'il inspire décrivent le passage à l'acte. Le retour du réel par-delà les notions que colportent et reproduisent chaque jour, à chaque moment, les classements, les classes sociales, les classes d'âge : c'est à dire, les journaux, les bavardages du bistrot, des magasins, etc. L'auteur se met à penser, lui même, au-delà des outils standards que mettent en place l'ordre social, les on-dit, l'école, l'université, la télé. Il n'est plus si sûr de la leçon qu'il a apprise ainsi sur le tas - mais nous n'en saurons rien, il n'avoue presque rien - et que cette leçon ait quelque chose à voir avec les élucubrations conceptuelles des enseignants d'une Ecole normale supérieure. Ah ! on est loin des astuces de Pour Marx (et l'on ne mentionera pas Lacan !) ! Et la conclusion du livre tombe, fracassante, pour l'intellectuel "établi", le philosophe du monde social : "Je pense : Kamel aussi, c'est la classe ouvrière". La distinction, donc ! "Gouffre de deux langues, de deux univers. J'essayais d'imaginer dans quel monde vivait Ali, comment il percevait les choses, et une impression d'infini me saisissait. Il aurait fallu parler des années, des dizaines d'années... " (p. 150).
Mais que peuvent faire les intellectuels dans cette bataille ? Ils sont nécessairement de l'autre côté, mais lisons un peu longuement L'établi : "Trois heures et demie. Qu'est-ce c'est que ça, encore ? L'atelier est envahi. Blouses blanches, blouses bleues, combinaisons de régleurs, complets-veston-cravate... Ils marchent d'un pas décidé, sur un front de cinq mètres, parlent fort, écartent de leur passage tout ce qui gêne. Pas de doute, ils sont chez eux, c'est à eux tout ça, ils sont les maîtres.Visite surprise de landlords, de propriétaires, tout ce que vous voudrez (bien sûr, légalement, c'est des salariés comme tout le monde. Mais regardez les : le gratin des salariés, c'est déjà le patronat, et ça vous écrase du regard au passage comme si vous étiez un insecte). Elégants, les complets, avec fines rayures, plis partout où il faut, impeccables, repassés (qu'est ce qu'on peut se sentir clodo, tout à coup, dans sa vareuse tachée, trouée, trempée de sueur et d'huile, à trimballer des tôles crues), juste la cravate un peu desserrée parfois, pour la chaleur), et un échantillon complet de gueules de cadres, les visages studieux à lunettes des jeunes ingénieurs frais émoulus de la grande école, et ceux qui essayent de se faire la tête énergique du cadre qui en veut, celui qui fume des Marlboro, s'asperge d'un after-shave exotique et qui sait prendre une décision en deux secondes (doit faire du voilier, celui-là), et les traits serviles de celui qui trottine juste derrière Monsieur le Directeur le plus important du lot, l'arriviste à attaché-case, bien décidé à ne jamais quitter son supérieur de plus de cinquante centimètres, et des cheveux bien peignés, des raies régulières, de coiffures à la mode, de la brillantine au kilo, des joues rasées de près dans des salles de bain confortables, des blouses repassées, sans une tache, des bedaines de bureaucrates, des blocs-notes, des serviettes, des dossiers..." (pp. 168-169). Mais la "Rationalisation" (la majuscule est de l'auteur) qu'importent et imposent ces acteurs du vrai monde social, a le temps ! Et les ouvriers qui pensent de travers : Ali déclarera à Robert :"Mais tu peux pas être juif. Toi, tu es bien. Juif ça veut dire quand c'est pas bien." (p. 150). Que faire ?

Et le voilà, à la fin du film, lui le fils d'immigrés polonais qui donne un cours sur Hegel, sans doute sur la Phénoménologie de l'esprit (que venait de traduire en français le directeur de son école) à des étudiants de Vincenne, jeunes petits bourgeois quelque peu subjugués par l'étrangeté du sujet (et il y a de quoi !). Lui est en costume, le même peut-être que celui que porte le directeur, chez Citroën. Citroën dirigée par des anciens élèves de grandes écoles, peut-être des polytechniciens. Le film et le livre racontent la même histoire, l'un en 1978, l'autre en 2023. Quarante cinq années les séparent, cinquante cinq années de l'événement raconté pour le film. Qu'est-ce qui a changé ? Citroën ne fabrique plus de 2 CV. Les usines parisiennes ont fait place à un parc André Citroën. Et à part cela ?
Le livre de Robert Linhart est remarquable. honnête. Très bien écrit. Le film est clair, bien conduit, il rend certains des personnages sympathiques ; pour que l'on comprenne, on nous donne à voir l'appartement de Robert, son enfant, sa femme. Car dans le film on voit des femmes aussi. Et on voit Robert aussi, redevenu enseignant, et racontant Hegel. L'histoire est en marche ...
.jpg)

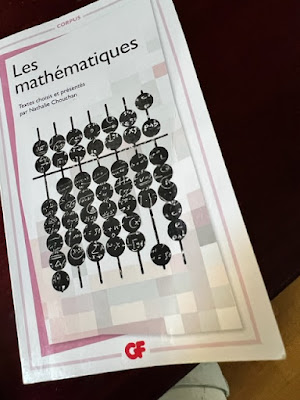


.jpg)









.jpg)
.jpg)

.jpg)



