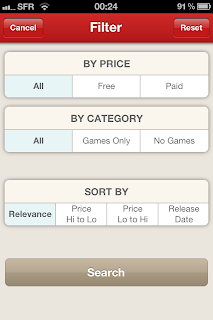|
| Copie d'écran de la couverture (iPad) |
- Les institutions politiques se rapprochent de l'étiage de la confiance : le Congrès (assemblées élues) est à 10%, la Présidence et la Cour Suprême sont entre 30 et 40%, le système judiciaire est au-dessous de 30%.
- L'école et la santé publiques se situent entre 30 et 40%. Les banques, en chute libre, sont passées en dix années de 58 à 23%.
- Les organisations syndicales se situent vers 20%, à peine au-dessus des grandes entreprises.
- Les médias d'information, journaux et télévision, sont passés au-dessous de 30%.
"Pourquoi les Américains détestent-ils les médias ?" demande Jonathan M. Ladd dans un livre de science politique paru en janvier ("Why Americans Hate the Media and How It Matters", Princeton University Press, 2012, 282 p., Bibliogr., Index.).
L'auteur parcourt d'abord l'histoire de la presse à la recherche d'une réponse.
L'auteur parcourt d'abord l'histoire de la presse à la recherche d'une réponse.
- Première période, celle de la professionnalisation du journalisme et du prestige social qui l'accompagna. Augmentation des lectorats, des revenus publicitaires, réduction de la concurrence. La télévision, au début de son histoire, se développe dans un univers également oligopolistique. Dans cette situation favorable, les médias d'information (news media) s'uniformisent et s'autonomisent pour devenir une institution politique à part ("their own political institution") courtisée par le monde politique. "Quatrième pouvoir", la presse ferait l'élection. Cet âge d'or des médias d'information s'achève avec les années 1970.
- Depuis, l'institution médiatique voit son statut s'affaiblir alors que la vie politique se repolarise (partisanship) et que les médias s'émiettent, fragmentant les points de vue. Les choix des électeurs se restreignent, ceux du lecteur se dispersent. Cette dispersion culmine avec les médias numériques : le Web attise la concurrence. Polarisation de la vie politique et fragmentation des médias d'information convergent en attaques contre l'information institutionnalisée.
 |
| N° spécial de l'Humanité quotidien communiste, 12 /6/ 2012. |
Selon les enquêtes de l'auteur, deux causes semblent d'abord expliquer la défiance des Américains envers les médias d'information : une "rhétorique partisane" exacerbée et le format tabloïd de l'information. En conséquence, la défiance renforce à son tour le vote partisan, restreignant l'intérêt pour l'information et le débat économique. En même temps, l'évolution de plus en plus concurrentielle du marché de l'information aiguisée par la recherche lancinante de l'audience conduisent à privilégier une information de type "soft news", qui mêle, à une info simplifiée, du people et des faits divers. CQFD.
La science politique et la sociologie électorale françaises peuvent trouver des hypothèses explicatives à tester dans le travail de J.M. Ladd. Comme aux Etats-Unis, les médias français se fragmentent et s'éloignent de l'information dure, rigoureuse. Comme aux Etats-Unis, la bipolarisation de la vie politique française subit des variations mais la tendance actuelle (obstacles multiples à l'entrée dans le jeu électoral) semble favoriser le bipartisme. Quelle confiance l'électorat français accorde-t-il aux médias d'information, à l'institution médiatique ? Cela reste à évaluer. L'évolution du jeu politique français explique-t-elle, au moins partiellement, les difficultés des médias d'information ? J.M. Ladd devrait tester ses conclusions sur le cas français...
 |
| Source : sondage Gallup aux Etats-Unis (juin 2011), échantillon national 1020 personnes de 18 ans et plus. |